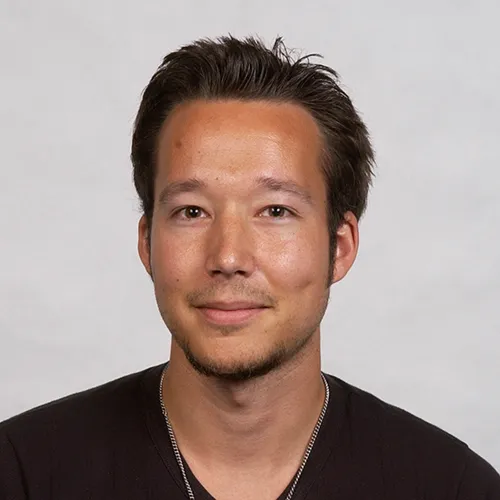Travail et intégration sociale
L’intégration des personnes présentant un handicap est une question centrale, du point de vue des personnes concernées comme d’un point de vue sociopolitique. Cette préoccupation a été confirmée par l’adhésion de la Suisse à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, en 2014.
L’objectif du programme de recherche est de comprendre, de manière globale, comment les limitations liées à la santé influencent, en interaction avec les facteurs environnementaux et personnels, l’intégration et la participation sociales des personnes handicapées. La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (ICF) en constitue le cadre conceptuel.
Grâce à notre recherche appliquée, nous essayons d’identifier, en particulier, les conditions préalables à l’intégration professionnelle durable des personnes atteintes de paralysie médullaire. À cette fin, nous étudions les facteurs qui contribuent ou font obstacle à la satisfaction et à la santé des personnes concernées et qui jouent un rôle dans le maintien des personnes dans le monde du travail jusqu’à l’âge de la retraite. Les connaissances tirées de nos recherches fournissent des données permettant d’optimiser les propositions d’aide existantes et d’en proposer de nouvelles aux personnes paralysées médullaires qui exercent une activité professionnelle.

Projets de recherche
Réinsertion professionnelle
En Suisse, plus de 50 % des personnes atteintes de paralysie médullaire exercent une activité rémunérée, soit environ 30 % de moins que la population dans son ensemble. Les programmes de réinsertion professionnelle ont pour objectif d’intégrer à long terme les personnes concernées à une activité satisfaisante et donnant du sens à leur existence et ainsi d’augmenter le taux d’activité des paralysés médullaires. Ces programmes ont donc besoin d’une connaissance globale et solide des facteurs qui influencent la réinsertion professionnelle des personnes concernées à court, moyen et long terme.
Sur la base des données de l’étude de cohorte suisse sur les lésions de la moelle épinière (SwiSCI) et en étroite collaboration avec l’institut de réinsertion professionnelle (ParaWork) du Centre suisse des paraplégiques (CSP), nous menons des projets de recherche visant à déterminer les facteurs qui favorisent ou entravent la réinsertion professionnelle durable des personnes souffrant de paralysie médullaire. Outre l’analyse des différentes possibilités de réinsertion professionnelle, nous nous consacrons en particulier à la manière de faire correspondre au mieux la personne et l’emploi. Notre but ultime est de générer des accroches pour des interventions orientées vers une réinsertion professionnelle durable des personnes paralysées médullaires.
Insertion durable sur le marché du travail
Au cours des dernières années, les connaissances sur la manière d’aider au mieux les personnes handicapées suite à un accident ou à une maladie à retrouver une activité professionnelle ont augmenté en continu. En revanche, nous ne savons encore que peu de choses sur les facteurs qui permettent à ces personnes, après avoir repris une activité, de rester durablement dans le monde du travail, jusqu’à l’âge de la retraite, de manière satisfaisante, durable et en bonne santé. Les données issues de l’étude de cohorte suisse sur les lésions de la moelle épinière (SwiSCI) confirment les observations réalisées à l’échelle internationale selon lesquelles les personnes souffrant d’une lésion de la moelle épinière quittent plus souvent prématurément le monde du travail que la population moyenne.
Il est de plus en plus largement admis qu’une lésion de la moelle épinière ne nécessite pas seulement une rééducation immédiate, mais aussi une gestion de la santé tout au long de la vie, dont l’objectif est une participation (au travail) optimale.
Pour aider au maintien durable dans une activité professionnelle optimale, nous devons connaître les facteurs d’influence pertinents et leurs modes d’action et mieux comprendre leurs interactions. Nous obtenons des connaissances fondamentales à ce sujet en examinant et en évaluant les parcours professionnels.
Investigations sur l’aptitude à l’emploi
Les investigations sur l’aptitude à l’emploi se basent sur une expertise médicale. Elles servent de base pour décider si une personne assurée auprès de l’AI, de la Suva ou d’une assurance privée peut prétendre à des indemnités journalières, à une pension ou à des mesures de réinsertion. Pour que les décisions soient les plus justes possible, les expertises médicales doivent évaluer l’aptitude au travail de manière comparable. Elles doivent également présenter clairement comment l’évaluation a été réalisée.
Il faut pour cela s’éloigner de l’approche biomédicale et diagnostique qui a longtemps prédominé et se tourner vers un modèle biopsychosocial qui remet au centre des préoccupations l’aptitude fonctionnelle au travail de la personne. Une expertise fonctionnelle et biopsychosociale peut montrer comment les limitations liées au handicap et les facteurs contextuels environnementaux et personnels peuvent influencer la capacité d’une personne à satisfaire aux exigences d’une activité professionnelle précise. Sur la base du modèle biopsychosocial global de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (ICF), nous nous consacrons au développement d’outils fonctionnels qui augmentent la standardisation et la transparence des investigations sur l’aptitude à l’emploi.
Werden Sie jetzt Mitglied und erhalten Sie im Ernstfall 250 000 Franken.